Vous pouvez cliquer ci-dessous
sur la période choisie :
1°) INTRODUCTION
2°) L' HABITAT - Période antique
3°) L' HABITAT - Moyen-âge
4°) LES TEMPS MODERNES
5°) XXème Siècle
6°) XXIème Siècle (notre époque)
7°) Un étrange pays
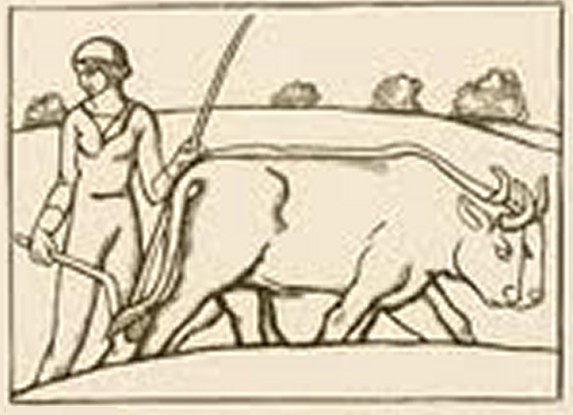
INTRODUCTION
Le territoire de la paroisse de La Bastide n'a pas toujours été tel que nous le connaissons aujourd'hui : les bouleversements climatiques, démographiques, politiques et économiques et -par-dessus tout – le travail des hommes ont, au fil des siècles, façonné le paysage, les lieux d'habitat et les mentalités. Que de changements intervenus, par exemple, au cours des sept derniers siècles ! Par exemple au Moyen-âge le paysage agricole était « ouvert » , c'est à dire que les nombreux murs qui séparent aujourd'hui les parcelles n'existaient pas ..., la plupart des maisons n'avaient pas d'étage et abritaient trois générations d'une même famille dans seulement 36 mètres carrés …, le mobilier était presque inexistant : une table , un banc , un coffre... , certaines terres étaient possédées en commun …, on ne pouvait changer la nature des cultures sans l'autorisation du seigneur … et d'ailleurs on n'était pas réellement propriétaire de sa maison ou de ses terres que l'on louait à perpétuité … ! Il n'y avait pas d'école jusqu'à la révolution..., beaucoup d'enfants mouraient l'année même de leur naissance …, quelle que soit sa classe sociale on n'était jamais assuré d'avoir suffisamment à manger …
La liste serait longue des révélations qu'apporte la connaissance du passé. Notre propos n'est pas seulement de rapporter les différences entre avant et maintenant mais de les mettre en relation , de souligner les lentes évolutions et de faire mieux connaître la vie dans les temps anciens en suivant trois grand axes d'analyse : l'HABITAT , les HOMMES et leurs ACTIVITÉS , la TERRE .
Ces lignes trouveront leur intérêt dans cette réalité que la vie dans la région des Boraldes - ni encore vallée du Lot, ni déjà Aubrac montagnard - n'a que très rarement été décrite ou analysée, alors même que, située à l'interface de deux systèmes de vie et de travail, elle possède une spécificité historique peu appréciée à sa juste valeur.
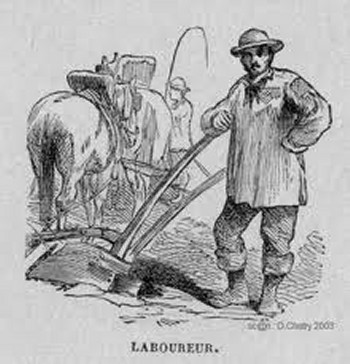
L'HABITAT
LES VILLAGES
La période antique
Indiquons tout de suite qu'à l'exception d'un toponyme Peyro lebado existant encore au XVII° siècle à Tilières, qui pourrait faire référence à un éventuel menhir « préhistorique », on ne sait rien de la période pré-antique sur le territoire étudié.
On n'en sait guère plus sur la période d'occupation gauloise, sauf par le toponyme du Lucadou situé en dessous d'Auriech et qui désignerait un « bois sacré » celtique !
Par contre la période gallo-romaine a laissé des traces : concrètes tout d'abord puisqu'en deux endroits du territoire, La Roque et Les Tieires, on a retrouvé des tegulae ou tuiles romaines, indices certains de la présence d' habitats ; le premier site a même fourni des poids de tisserand ; trace évidente d'une activité de tissage et indice probable de l'élevage de moutons dont on utilisait la laine.
Des traces abstraites mais viables d'occupation gallo-romaine existent également sous la forme de toponymes en « ac », typiques de cette période : COURBESSAC qui deviendra La Courbenque et BASSINHAC, lieu encore habité à l'extrémité nord du village d’Auriech.
Ces habitats font partie d'un chapelet régulier de sites gallo-romains qui s'étendait d'Espalion à Aubrac ! On ne connaît pas l'époque de l'installation gallo-romaine ni sa durée mais un indice nous a été donné par la découverte au XX° siècle dans un champ « près de La Bastide » d'une pièce en or portant l'effigie de l'empereur Justinien II (...-.....) : le site était donc fréquenté au moins au 6° siècle de notre ère …, mais il est difficile d'indiquer la densité de population dont les activités devaient être agricoles avant tout.
Le Moyen-âge
a) Le Haut Moyen-Age
Cette époque est la plus mal connue de notre ère, en Aveyron comme en France et en Europe...
La période s'étalant de l'An 500 à l'An 1000 n'a laissé aucune trace d'occupation actuellement analysable ; il est toutefois probable que la région ait été habitée comme en témoignent deux toponymes en « enque » caractéristiques d'une occupation franque : LA COURBENQUE, sur le site de Courbessac et SAGNALBEYRENQUE qui deviendra Le Sagnas, terroir situé sur le plateau.
Cette période vit, dans notre région comme dans tout le pays, le découpage du territoire agricole en manses (±) : étendue compacte de terres à usages divers gérée par une seule famille. Exploitation comptant entre 25 et 30 hectares dans notre région, le manse originel a parfois survécu jusqu'à nos jours comme à Bieysses ou aux Fieux
b) Le Bas Moyen-Age
A partir de l'An Mil l'image que l'on a de la région se précise ; les moines de Conques mentionnent des défrichements aux alentours de Saupiac par la hache paysanne (rustica framea). En 1060 le pont d'Espalion est mentionné, de même que la chapelle de Perse lieu d'attraction pour les pèlerins de Saint-Jacques... et les autres... . Au siècle suivant deux établissements religieux d'importance s'installent à quelque distance du territoire ; c'est d'abord l'Hôpital d'Aubrac en 1120 -dédié à la sauvegarde des pèlerins- puis le Monastère cistercien de Bonneval bâti en 1147 en une « horrible solitude » dans un lieu cependant déjà défriché par des paysans !
Ces deux établissements étaient forcément reliés par une voie de communication: en …. Le porteur du rouleau des morts de Bertrand des Baux accomplit en seulement un jour le trajet Aubrac-Bonneval, indice probable de l'existence d'un chemin entre les deux établissements, lequel chemin pouvait passer -pour être le plus court possible- sur l'actuel territoire de la paroisse.
L'important bourg de Saint-Côme apparaît sans doute au milieu du XIII° siècle.
Il nous faut ensuite attendre 1278 pour apprendre que la « villa » de La Bastida dépend d'Aubrac ; un an plus tard on apprend qu’Aubrac, par l'intermédiaire de son prieuré de Lévignac possède une chapelle dont tout porte à croire qu'elle est celle de La Bastide. Par une étrange ironie le premier village mentionné dans les textes est pourtant à l'époque le plus récemment construit ; les « bastides » n'ont en effet été édifiées qu'à partir de 12... .
Avant l'édification de « La Bastida », il semble que l'habitat de la zone était constitué de MANSES, c'est à dire de territoires mis en valeur par les habitants d'une ferme isolée. Ces manses se juxtaposaient entre eux et voisinaient parfois avec de grandes étendues incultes, les VACANTS ou TERRITOIRES, sortes de friches appartenant au seigneur qui pouvait parfois concéder aux habitants des manses voisins des droits de pacage ou de « mort-bois ». Quelques-uns de ces manses ont conservé de nos jours l'emprise territoriale qu'ils avaient autrefois ; c'est le cas de Bieysses, de Bancs, des Fieux, terroirs qui n'abritent toujours qu'une unique ferme. D'autres comme La Passe, Ruols et Auriech ont été partagés, les manses de La Courbenque et de Puéméja ont, eux, été délaissés au cours du XX° siècle. Les manses de Calmias et de La Garnayrie étaient déjà abandonnés à la fin du Moyen-Age . Le manse de Cantamesse doit sans doute son existence à l'implantation de Bonneval, peut-être était-ce l'habitation d'un chantre qui « chantait la messe » ; au XV° siècle le tenancier était en tout cas marguillier dans l'église d'Aunac donc homme d'église.
Enfin il semble que La Bastide -sur laquelle nous reviendrons- ait été surimposée à deux manses préexistants, le manse Teysseyre et le manse Revel, établis à proximité de l'actuelle fontaine du village, la division communale actuelle porte encore les traces de leur emprise dans son tracé tourmenté.

La Renaissance est le premier Age d'Or de la région : l'augmentation de population liée à des conditions d'exploitation favorables voit le dédoublement de manses surpeuplés comme La Passe ou Cantamesse ( ce qui aurait donné naissance à Marrels) ou le partage d'exploitations villageoises comme celle des Bourgade à La Bastide. Par ailleurs de nouvelles maisons se construisent, servant de centre à de nouvelles exploitations tant à La Bastide qu'à Auriech. Mais à ces nouveaux paysans il faut des terres plus nombreuses d'où découlent les défrichements de terroirs jusque là sous-exploités comme Lardade ; le lotissement en commun de nouvelles terres ou même le partage des anciens communaux (comme les Landettes vers 1586), souvent constitués de pâturages, bois ou friches. On peut citer en exemple le partage du bois de Tilières dépendant d'Aubrac : en 1597 un habitant de La Passe reconnaît « sa part du bois de Tilières », encore possédé en commun par une douzaine de paysans, mais le cadastre de 1665 nous montre chaque habitant disposer en propre d'une partie de ce communal démembré.
A l'époque des rois absolus, au XVIII° siècle, deux nouveaux habitats sont créés : Bel Air et La Cessat, des fermes villageoises sont partagées et de nouvelles tenures paysannes sont morcelées dans les finages d’Auriech, de Ruols et de La Bastide. C'est le signe d'un accroissement de population et d'une certaine prospérité.
La Période post-révolutionnaire :
Alors que La Bastide et Auriech ont évolué en villages populeux (près de 150 habitants chacun)..., les manses ont gardé leur forme primitive. Suivant l'accroissement démographique et l'adoucissement du climat, le nombre de « propriétaires-cultivateurs » - dont certains pauvres – est devenu très important dans les villages. Pendant cette période, une exploitation est édifiée au Cayroulet, lieu qui servait autrefois aux prêtres de Saint-Côme à percevoir les rentes en nature que les habitants des lieux versaient autrefois au Baron de Calmont...

Le XX° siècle
Le siècle passé a vu la population parvenir à un zénith avant de s'étioler sous les effets conjugués des deux guerres mondiales , de la mécanisation qui a rendu la main-d’œuvre agricole moins nécessaire et de l'exode rural qui a précipité bon nombre d'habitants vers les villes pour y gagner un espoir d'ascension sinon sociale du moins économique.
Les effets de cette saignée démographique ont été rudes : en un siècle le nombre de cultivateurs a diminué des deux tiers, entrainant l'abandon de nombreuses fermes et parfois de hameaux entiers comme à Marrels, à Puéméja. A La Bastide c'est plus de la moitié des exploitations qui ont disparu, seules les plus solides demeurant en place.
Le XXI° siècle
Il est bien sûr trop tôt pour savoir ce qu'il adviendra de ce siècle encore balbutiant, mais des signes existent : si le nombre d'agriculteurs se maintient peu ou prou malgré les difficultés du « vivre et produire au pays », on a vu un habitat moderne s'installer le long de la route d'Aubrac et l'on voit également des maisons ou fermes abandonnées être rachetées et habitées de façon plus ou moins régulière. Le maintien des agriculteurs au pays et l'arrivée de néo-ruraux dans d'anciens bâtiments ou de rares constructions contemporaines semble préfigurer l'avenir de cette parcelle d'Aubrac.
Thierry Quintard
Historien de la Bastide d’Aubrac
Notes :
(±)
Un manse est à l'origine une tenure correspondant à une parcelle agricole suffisamment importante pour nourrir une famille. À l'époque mérovingienne il est désigné comme une terre cultivée par un affranchi.
Si sa superficie est assez précise, dès l'époque carolingienne, cette unité recouvre des superficies très différentes selon les régions. Elle sert essentiellement à la fiscalité. Souvent regroupés en colonicaeou collongues, les manses étaient occupés par des rustici ou coloni (paysans ou colons) qui devaient au seigneur une partie de leur récolte ou un service. Le manse est utilisé, pour la France, au Moyen Âge et à l'époque moderne.
Dans le sud de la France, manse est devenu mas, désignant une ferme, une habitation, mais aussi un quartier, puis par extension un village.

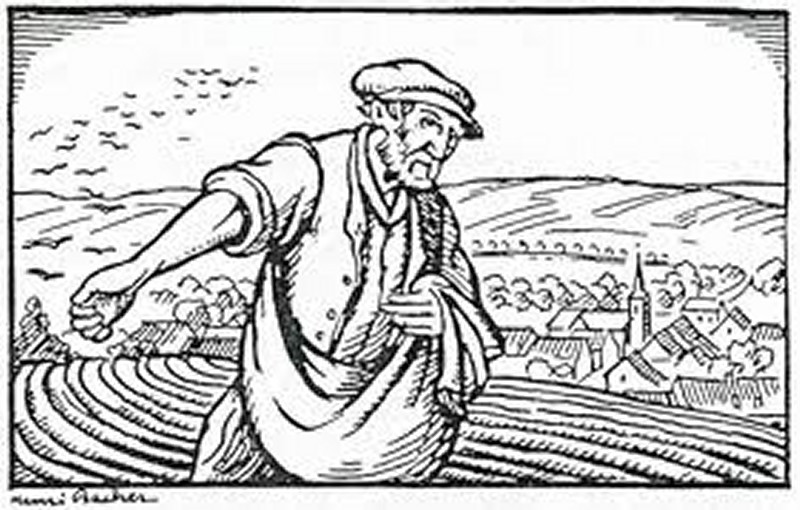

Étrange
pays que celui de La Bastide sous l'ancien régime, étrange et parfois
inquiétant. En effet dans une campagne où se dressent de nombreuses MURAILLES on
voit MERCENAIRES, TRAFIQUANTS et autres ACOLYTES se livrer à leurs activités
n'hésitant pas pour cela à plonger dans des endroits SCABREUX dans lesquels ils
ne sont pas surpris de rencontrer des BREBIS TURQUES égarées !
En plus de cela il n'est pas rare de
trouver des hommes à cheval réclamant de l'argent pour fournitures de drogues.
Heureusement, il y a des PARADIS d'où sortent parfois d'HONNETES FEMMES qui
rencontrent de temps en temps des HOMMES SAGES , DISCRETS , CIRCONSPECTS et dans
tous les cas RECOMMANDABLES …
Vous l'aurez compris , ces noms pittoresques ne sont que d'anciennes appellations désignant des réalités très prosaïques:
-
murailles :murets
délimitant des parcelles
- mercenaires : paysans sans terre vendant leurs bras au plus offrant
- trafiquants : marchands
- scabreux : se dit d'une pente rocheuse , raide et broussailleuse
- brebis turques : qualificatif relatif à l'âge , l'agnelage ,d'une brebis
- drogues : remèdes , souvent amenés dans les hameaux par des médecins se déplaçant à cheval
- paradis : se dit d'une parcelle abritée du vent
- honnêtes femmes : femmes ayant du bien , de l'argent
- hommes sages ,discrets , circonspects , recommandables : différents degrés d'appréciation des hommes selon leur expérience, leur confidentialité et leur fiabilité.
Thierry Quintard